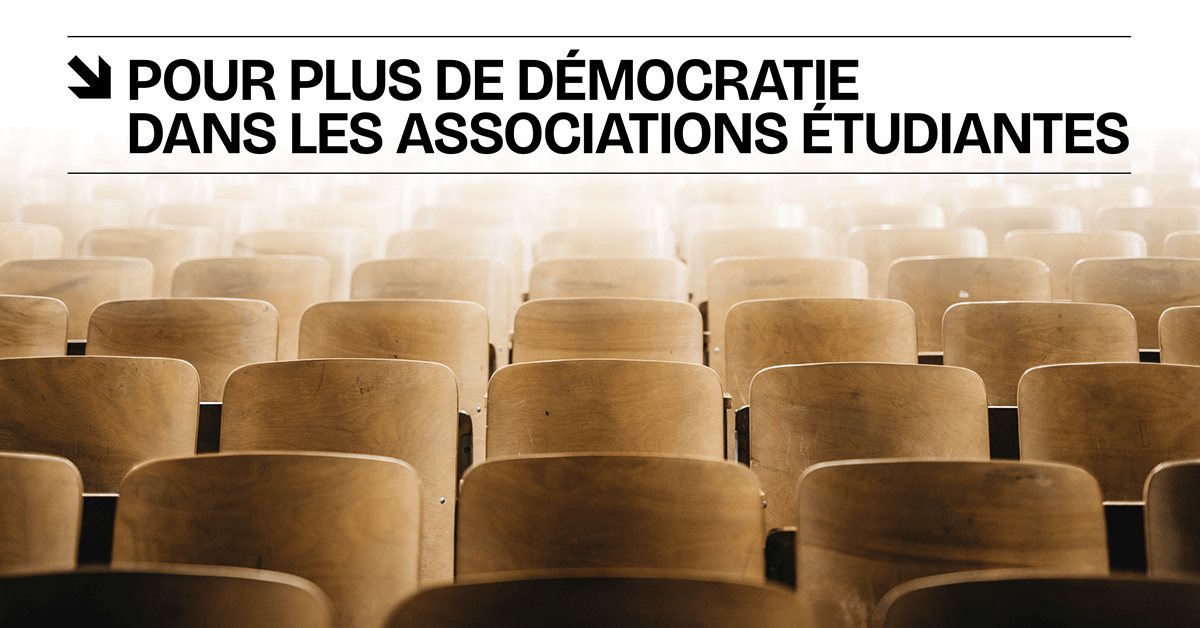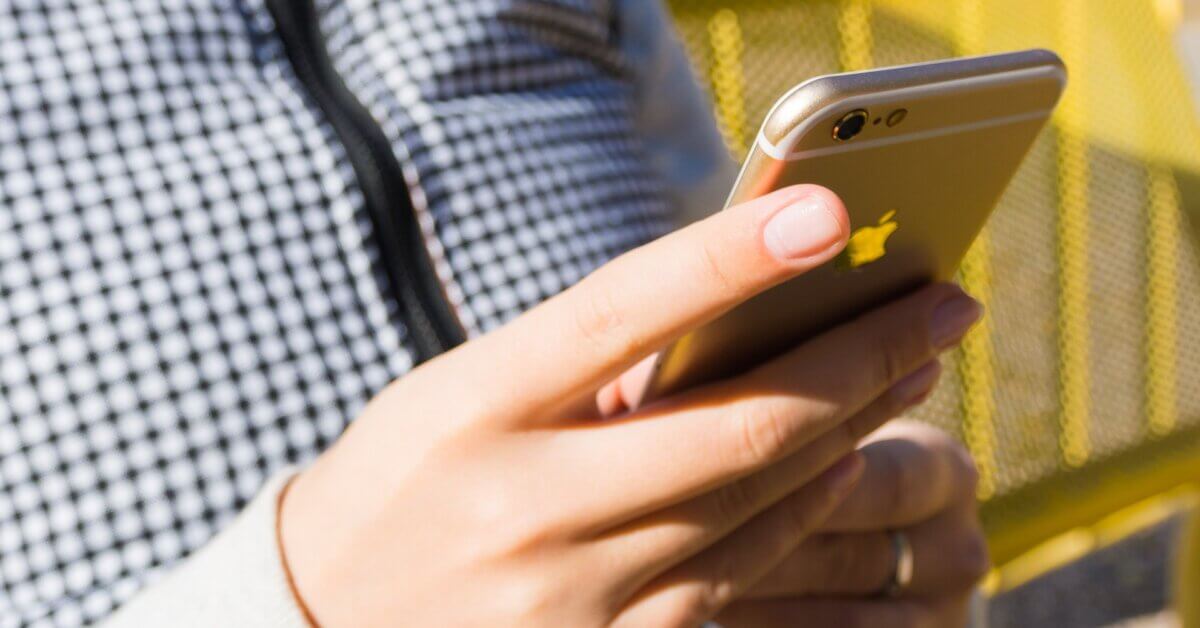Congrès CRCAQ 2025 : Ça a brassé !

12 juin 2025
Le congrès annuel de la Commission de la Relève de la CAQ (CRCAQ), qui s’est tenu le 7 juin dernier à Lévis, a de nouveau été un franc succès, celle-ci étant parvenue une fois encore à imposer ses idées dans le débat public. Les membres présents ont porté haut leurs convictions et ont fait preuve de courage en dénonçant les dérives des syndicats et des associations étudiantes.
La journée a débuté avec une allocution du ministre Bernard Drainville, suivie d’un discours passionné livré par notre présidente sortante, Aurélie Diep, au cours duquel elle est revenue sur les deux dernières années en soulignant les succès de la Relève qui est parvenue à imposer ses thèmes à plusieurs reprises tout en se développant considérablement. Ce fut également l’occasion pour la présidente d’introduire le sujet du jour en soulignant la nécessité d’introduire des règles du jeu plus justes pour les syndicats et les associations étudiantes.
« La transparence et l’intégrité sont les conditions de la confiance ! »
– Aurélie Diep
Nous sommes par la suite rentrés au cœur du sujet de cette grande journée en entamant les premiers panels « Quel marché du travail pour les jeunes d’aujourd’hui ? » et « Associations étudiantes : démocratie ou dictature de la minorité ? ». Cinq brillants panélistes se sont succédés pour mettre en lumière les dérives des syndicats et insister sur le rôle à venir de la jeunesse, dans le monde en général et celui du travail en particulier.
Ce fut l’occasion pour nos membres de débattre du fond sur ces questions en discutant en détails des propositions mises au vote et en défendant leurs amendements. Les débats furent de haut vol et les membres ont démontré avec brio leur engagement pour faire avancer les idées de la CRCAQ.
Après une courte pause, ce fut le temps de siffler le coup d’envoi des présentations des candidats. Il est à souligner que pour la première fois, ce sont deux équipes presque complètes qui se sont fait face lors de cette campagne pour remplir les postes de l’exécutif de la Relève.
Après un nouveau panel portant sur « L’économie québécoise dans un monde en mouvement », est venu le moment de dévoiler le nouvel exécutif élu par les membres. Après une course endiablée, William Denis a été élu Président de la CRCAQ et a livré un discours de victoire donnant les priorités pour son mandat :
« Notre parti, c’est celui dans lequel on peut tous se retrouver. Celui qui rassemble des jeunes, de toutes les couches de la société peu importe leurs salaires ou leurs diplômes, mais qui travaillent tous fort pour acheter leur première maison. Pour prendre soin de leur famille. Et pour laisser un Québec meilleur, un Québec français et laïque, aux générations futures. »
– William Denis
En rappel, voici les propositions adoptées par les membres lors des plénières :
RAMENER LA DÉMOCRATIE DANS LES SYNDICATS ET LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
- La CRCAQ propose de restreindre l’utilisation des cotisations des membres par les associations syndicales et étudiantes, ainsi que leurs dirigeants, afin qu’elles ne servent pas à des fins partisanes ou sortant de leur mission.
- La CRCAQ propose de rendre obligatoire la publication détaillée des dépenses des associations syndicales et étudiantes, et de leurs dirigeants.
- La CRCAQ propose que les résolutions prises par les associations syndicales et étudiantes autorisant le déclenchement d’une grève, ou une prise de position ou une dépense n’entrant pas dans leur mission soient soumises à un vote à la majorité du total de leurs membres.
ASSURER LA RIGUEUR DU TRAVAIL AU SEIN DE L’APPAREIL GOUVERNEMENTAL
- La CRCAQ propose de renforcer les exigences des titulaires d’un emploi supérieur en matière d’éthique, de déontologie et de bonne gouvernance, et de faciliter leur congédiement en cas de manquement grave.
- La CRCAQ propose un retour au travail en présentiel de trois jours pour les fonctionnaires et de quatre jours pour les gestionnaires.
RENFORCER LA PRÉSENCE QUÉBÉCOISE DANS LE MONDE
- La CRCAQ propose de faciliter le placement des jeunes dans des postes stratégiques à l’international et de soutenir leurs séjours de formation et de recherche à l’étranger, tout en encourageant leur retour au Québec.
- La CRCAQ propose de développer davantage le réseau diplomatique québécois, dans l’optique de diversifier nos exportations
COUPER DANS LA BUREAUCRATIE POUR LIBÉRER LA FORCE DE NOTRE ÉCONOMIE
- La CRCAQ propose de développer l’industrie de la défense au Québec, et de miser sur ce secteur à haute valeur ajoutée pour diversifier l’économie québécoise.
- La CRCAQ propose d’alléger de 50 % la paperasse dans le secteur minier, afin qu’il soit plus facile que jamais d’exploiter nos minéraux critiques et stratégiques.
- La CRCAQ propose la mise sur pied d’un comité mixte sur l’allègement bureaucratique et fiscal, regroupant des représentants du gouvernement et des industries.